
Rappel des faits :
Selon ceux validés par sa biographie officielle (trois lignes),
Evan Dara est un jeune auteur américain, résident à Paris* ; son premier roman,
The Lost Scrapbook, fut publié par la formidable coopérative autogérée
FC2 après avoir été consacré vainqueur du douzième FC2/Illinois State University National Fiction Competition par un jury présidé par William T. Vollmann (en 1994, j’crois) ; il fut aussi adoubé par Richard Powers (« author of the
Goldbug Variations », wink wink), qui écrivit à son sujet que «
Dara démontre qu’un roman peut être à la fois expérimental, moral, iconoclaste et émouvant, post-humaniste tout en restant profondément humain (…), monumental, impitoyable, rusé et sincère, il n’abandonne personne sur le bas-côté de la route, le lecteur en premier lieu » et son exaltation était plus juste que la raison ; Powers y avait peut-être entendu, dans la catastrophe environnementale qui animait sa deuxième moitié, un écho de son chef d’oeuvre
Gain via la polyphonie d’une vox populi remarquable de réalisme aural et idéologique ; mais c’est par la forme que Dara accomplissait le prodige; son très, très bruyant roman revenait en effet au monstrueux
JR de William Gaddis - cette montagne de déchets informationnels qui répondait à l’inflation des mots et des bidules dans l’air, dans les conduits, dans les ondes, dans les nouvelles sur les bouts de papier volant par le tressaillement formel le plus violent et le plus pertinent de son temps – avec une invention sans nom et une maîtrise inespérée ; de fait, Dara, génial d’outrecuidance, reprenait en gros toutes les grandes problématiques du post-modernisme américain canal historique (entropie informationnelle, jongleries autoréflexives, perdition) pour figurer en métaphores et formes reverdies son roman d’anecdotes emmêlées et ne se paumait presque jamais. Enfin, c’était un roman très fougueux sur la jeunesse, aussi, qui parlait par ses mots et en son nom sans jamais vouloir lui faire faire sens sur sa place dans la grosse société, et c’était si saisissant que je ne crois pas avoir lu depuis de livre qui fasse mieux exister des jeunes dans son sein depuis (le discrètement radical
Project X de Jim Shepard, lu tout, tout récemment, s’en approche quand même tout près).
J’avais noté quelques descriptions des scènes folles qui font sa première moitié en le relisant, je vous les livre dans l’ordre du livre :
On revendique son droit à s’extasier devant un dessin de Escher ou d’un vase de Rubin et on compare les champs de coton à une toile de Mondrian
Un garçon tente la vérification de son existence au-delà du monde des fantômes en s’en retournant chez lui ; chez lui, il constate malheureusement que personne n’a joué sa vie à sa place en son absence
Des garçons tournent un film avec des lucioles, l’un d’entre eux est obsédé par les
Variations de la Valse de Diabelli et les contributions de Schubert, Liszt et surtout Beethoven qui en composa pas moins de 33
Un enfant quitte son père parce que son père ne lui a pas acheté le modèle de batterie qu’il lui avait commandé, et réalise des films d’animation sur la méiose et la mitose
On raconte les premiers jours de la Radio
On cause, on cause, des alinéas marquent les pauses, les rassemblements
On évoque la nature périssable du visage, sa résilience à la lumière
On apprécie un livre vivant, une encyclopédie de sa propre vie qui ne cesse de grossir, de s’épaissir comme on respire
On dit des choses importantes à la page 60 («
I mean, by now, we’re all well-versed in the inadequacy of language, so to speak, but I never feel this so forcefully as when I try to come up with some means of verbalizing the utter, total, and appaled revulsion anf subdisgust I feel at what has become of our political process »)
Comme dans tous les manifestes POMO on investit par le langage cette étrange issue vers laquelle tout convergerait, dont le dévoilement est sans cesse repoussé par nos efforts parasites
On rêve de former le parti de la Majorité Silencieuse, « The Negative Ones »
On s’interrompt, on est interrompu, on interrompt les autres et ça fait naître des exceptions langagières et typographiques comme chez Gaddis, comme chez Arno Schmidt (voire des nouveaux symboles, comme ces tirets exagérément longs)
On parle directement dans la tête des autres
On a lu son précis Deleuze &Guattari, on déracine :
… I have rooted you out…
On fait des speech à la radio et on fait semblant de n’avoir qu’un interlocuteur, VOUS
On s’organise en causant, contre la publicité et conte l’I.N.J.U.S.T.I.C.E, ça fait pousser des «
métastases d’indignité »
Une entreprise prisée associée à XEROX prévoit générer de l’énergie à partir des oripeaux jugés inutiles par la L.I.T.T.E.R.A.T.U.R.E (le 19ème siècle français) de la langue, via un système basé sur la technologie géothermale existante, «
For the first time we will be able to put inattention, incomprehension, and indifference to productivre use… (…) … For instance, we envision a time when a brief chat about car-pooling will power a wind-style exhaust fan for as long as four hours »
On mène une étrange quête sur la route, un walkman K7 sur les oreilles, à la recherche d’un acouphène très bavard dans l’oreille qu’on fantasme en signal radio, signal radio bientôt muté en audioguide métalangagier comme le protagoniste produit la narration du récit en cours ; de fait, ce voyageur en quête du signal se trouve bientôt parler - penser exactement à l’unisson avec lui ; de fait, c’est certainement lui qui le produit et qui l’énonce, et c’est un moment assez phénoménal dans la littérature qui survient à ce moment précis du roman :
… But that was not at all…
…For not very long thereafter…
… after perhaps an additional hour of glissading down the Interstate..
… and puttng several more tiny, rattletrap towns past me…
… I found that, to my slight surprise…
… I had, at some point…
… begun to talk along with my signal…
… That is, actually to recite, from memory, what I was hearing…
… in perfect mimetic synchronization…
… regardless of what I was seeing through my open windows
le voilà qui s’écoute penser, avant de s’enfoncer dans une forêt sauvage d’indécision pour se retrouver
On retrouve des champignons qui ressemblent à John Cage (et l’on sait quel cas immense ce gros mycophile de Cage faisait des champignons dans sa vie et ses Journaux, n’aimant rien tant d’autre que les cueillir puis les manger) ou à William Demarest
On rencontre des hommes des bois dans les bois, ennemis du monothéisme
On se perd dans cette forêt parce que les lieux n’y ont pas d’existence individuelle (comme sur la Route, m’avait glissé un jour un ami à propos du rôle de cette dernière dans les films de David Lynch) parce que leur différenciation est rendue impossible par la végétation : « trees and indifferentation », c'est écrit en toutes lettres
On va voir un gars qui s’appelle Ken jouer son dernier
show, qui tourne mal parce qu’un homme voudrait vider son corps de son sang sur la scène
On parle d’arbres et de Chomsky, c’est un livre politique, mais pas parce qu’on y évoque Chomsky car on y évoque son travail de linguiste plutôt que son activité de polémiste
On perd ses mots, persuadés que les pensées qui nous traversent ne sont pas les nôtres
On se fait l’avocat du diable pour la cigarette en industrie et on s’emballe sur Piaget, Todorov, Eisenstein et Superman
Un adolescent s’interroge, précisément, de savoir si ses interrogations ne sont pas un peu adolescentes, et on se croirait un peu dans une nouvelle d’Adrian Tomine
On livre des muffins et on s’épanche sur le bonheur du muffin qui sort du four. Au fond du bureau de l’entreprise de muffins, un apprenti Gibbs cuit des ordures à la poêle et se désole que l’art préfère les muffins aux ordures liquéfiées (c’est une scène déconcertante)
On prétend être «
the weakest link in the great chain of being »
On reçoit des lettres magiques
On baise, en détails
On communique à travers des talkie-walkie de bébé à propos d’un boulot avec Noam Chomsky, puis un bébé fait un rot de mots
On fait très souvent référence à quelques figures illustres de la musique moderne, Ives, Cage ou Harry Partch
On relit ses mémoires et on constate que 66 des individus qui y sont mentionnés sont des inconnus
Un silence coupe le livre en deux
On invite Noam Chomsky à la télévision, on le fait venir à New York, puis on annule sa participation au dernier moment
Dans un centre commercial, on écoute au walkman exactement le même morceau de muzak qui flotte au même moment dans les airs de ses galeries
Pour se remettre de la mort d’Erwin la gerbille, on se perd dans une fête foraine, on cite Antoine Doisnel, on défie la gravité sur The Spinning Tilt, on part à la recherche d’un album photo mystérieux après la mort de sa mère, quelque part à Virginia Beach
Puis CATASTROPHE, un tuyau explose à proximité d’une école, quelque chose de hardcore qui survient (« A
nd there is hard
-wired, and hard
sell, and hard
ball ; and hard
bitten, and hard
news, and hard knocks ; and there is hard data, and hardnoses and hard currency »), et la vox populi dissout les êtres ; le roman devient une charge ; un écho de
The Origin of the Brunists, une réponse à
Gain, un tissu de rumeurs où tous cherchent à extirper la Vérité d’un terrible événement pour faire agir la Justice, en vain, c’est l’évidence. La méditation sur la déliquescence du data dans le bruit prend alors un sens tout autrement crucial, tout autrement engagé ; rien ne peut plus se savoir et les gens en crèvent : «
But the whole question is still open, if you ask me ; where are the facts?; show me some solid information ; all I hear is galloping speculation, all of it unconfirmed, and I know I’m not going to bother myself with hearsay-otherwuse, you’d see me out in Highland Park with my head shaved (…) ; despite all the scuttlebutt nothing has yet been produced – and when and if something concrete is produced I’m sure i twill serve to put the whole thing to rest », ce qui n’arrive jamais.
On y voyait assez clair à la dernière page de ce grand truc : Evan Dara était un écrivain de l’indécision, du sens liquéfié par le boucan - le
SCUTTLEBUTT - et de la disparition des êtres dans les flots. Sans conclusion, le disque revenait après réclamations au Silence en l’invoquant cinq fois. Puis, treize ans après, Dara est revenu du silence :
The Easy Chain, autopublié par nécessité (il codirige
Aurora, la petite maison qui publie) reprend la parole presque exactement, techniques et problématiques, là où s’était tu
The Lost Scrapbook : un personnage du nom de Robert Scapes, enfermé en prison, précise à la page 451 qu’il se voit en lobbyiste de la vérité :
«
It was like I was a lobbyist, lobbying for the special interest known as the truth ».
Comme l’augure son titre, ce gros roman est également une chaîne de mots, et d’histoires ; comme l’expose son
artwork transparent, son sujet est son personnage principal, existant en creux dans le torrent d’anecdotes, de mensonges et de fantasmes qu’on susurre, badine ou hurle à son propos (et, quelque part, à quelques rares occasions, à son attention). La parole est à la ville de Chicago, à son milieu huppé, à ceux qui ont croisé sa route ou qui se vantent de l’avoir croisée. L’éminent éminent commentateur du post-modernisme US Tom Leclair (si vous n’avez pas lu
The Art of Excess, son livre sur
JR,
Gravity’s Rainbow, Something Happened de Heller,
LETTERS de John Barth,
Women and Men de McElroy et
Always Coming Home de Ursula LeGuin, eh bien faites-le) vous guidera précisément à propos de ce que la forme dit sur l’intrigue, sur le
Bookforum :; pour le reste, sachez que tout commence avec des mots dits, des mots et un homme déguisé en boule à facettes et que ça en dit plus long sur
that guy Lincoln Selwyn (le héros, donc) que toutes les histoires sur son compte ; sachez aussi que, contrairement à la première moitié de
The Lost Scrapbook, The Easy Chain adopte bel un bien un récit continu, malgré les ellipses énormes qui hachent et rythment en permanence son déroulé très singulier (à chaque retour à la ligne, ou presque), et que la myriade d’histoires qui fait son cœur se tisse depuis son intérieur, qu’il y a donc moins à s’effrayer de la diffraction que de tendre l’oreille et de se laisser aller car de complexité, il n’y a pas vraiment, il n’y a qu’une salve d’auralité et d'oralité à entendre et à suivre en toute linéarité, comme la vie ou presque;
comme l’écrit LeClair (qui a eu la chance d’échanger quelques emails avec Dara),
The Easy Chain est un peu son
JR à lui, en cela que son sujet est proprement et presque intégralement l’homme dans le capitalisme (ce que nie Dara, en même temps que son attachement à Gaddis qu’il dit n’avoir jamais lu – et on le croit volontiers, notre temps précédant si fort en tout le boucan de ses livres qu’il est même surprenant que les formes gadissiennes n’aient pas éclot plus souvent ailleurs) et sa dissolution dans les histoires et dans le papier ;
l’histoire tient donc sur un mouchoir sale: A) Selwyn est anglais, il a grandi aux Pays-Bas, il est médiocre et dépressif jusqu’à son arrivée à Chicago quand il devient par un amoncellement indicible d’ellipses (ce qu’il fait, qui le sait ? – en fait c’est un livre de silences au moins autant que de bruits) et avec l’aide d’une certaine Auran qui lui est vouée corps et âme, un agitateur et un petit roitelet du microcosme hyper-capitaliste et un prodige dans les yeux de ses subordonnés, dans les fêtes luxueuses, dans les bureaux de ses admirateurs, en haut des gratte-ciels comme JR le gamin de
JR devient magnat du vide en s’insérant dans le chaos des conversations, des télégrammes et des appels téléphoniques des agents actifs et inactifs du capitalisme ; il agit, il émerveille, il sourit, il absorbe, il rejette, il caresse, il violente, il cherche, il souffre (d’un mal appelé
skonk ou syndrôme de Zynkofsky qui le fait éternuer jusqu’à la douleur), il séduit, il travaille peut-être avec Kissinger, il cherche, il cherche sa tante et c’est la principale sous-intrigue qui subsiste en arrière-plan ; puis au bout de 200 pages d’histoires par milliers (de une ligne à 30 pages, de l’histoire prodigieuse d’un homme dont les mésaventures conjugales le condamnent à faire sans cesse l’aller et retour entre deux maisons similaires jusqu’aux meubles à une conférence sur «
the exploded marginal differentiation ») et d’interférences par millions B) il disparaît ; comme résume TK/Tracy qui part à sa recherche pour le compte d’on ne sait quelle publication (elle cherche autant un publicateur que l’étoile filante de son sujet:
To hear people say it, a comet arrived in Chicago last October. It went unnoticed by Yerkes Observatory. But within weeks, the fireball known as Lincoln Selwyn would shake up, transform and indeed ignite the city’s once-creaky social sphere, breathe new life into several major businesses and civic undertakings, and blaze a trail through (). And then it dispappeared
puis, après 40 pages blanches, il réapparaît aux Pays-bas, sur les traces de sa mère devenue corps errant dans la rue, sans domicile fixe; il n’opère alors plus grand chose ; derrière lui, un cortège d’agents haineux, manifestement décidés à lui payer son succès, lui file aux basques et se paume en conjectures (on les entend parler, éructer, affabuler et c’est tout :
-So it’s all there. The thieving, the instability, the geographical mobility, the detachment, the anhedonia, the conscience – the conscience-less-ness. All the paraconsumption indices.
-… I don’t know. I don’t believe too much of that warp. I just think he’s a dick.
-A Section 18B dick.
-Yeah. Maybe.
);
finalement, dans tout ce bruit, on entend à peine Lincoln sombrer, on l’entend à peine préparer son attentat, et on entend à peine la déflagration incroyable qui conclut le livre et, fait fabuleusement étrange, arrive après le point final du livre, son dernier jour de rédaction et un encart publicitaire pour Aurora la petite maison d’édition (
« First in a series. To receive further articles, please leave your name and adress, along with any contributions, at : www.aurora148.com") comme si Dara jouait à brouiller les limites entre les rumeurs dans le livre et les rumeurs du réel qui le font si singulièrement exister dans le monde des lettres, depuis la pénombre jusqu’à l’effacement ; d’autant que ladite déflagration – les derniers mots hurlés d’un détective privé que Lincoln, plus tôt dans le livre, payait pour retrouver sa tante, face audit Lincoln qui, passé dans un état de furie totale, le menace avec une arme à feu – est incroyable de violence et de radicalité et qu’elle laisse un étrange goût de métal en bouche quand on se la coltine d’une traite après avoir repris la lecture d’un livre qu’on pensait achevée dans un beau désordre irréalisé. Qu’il milite pour la vérité ou pour l’imagination (qu’il compare, à l’aise, à une forme d’allergie), The
Easy Chain est un livre très singulièrement renversant.
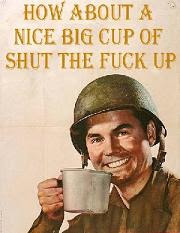
*on n’a jamais croisé sa route
Libellés : evan dara, richard powers, the easy chain, the lost scrapbook, tom leclair, william gaddis

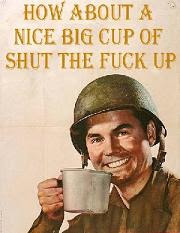
 Voyage à Tokyo (ceci dit comme tout le monde je préfère, largement, le titre original, 東京物語, un conte à Tokyo), un mauvais documentaire sur les lieux où le film fut tourné et
Voyage à Tokyo (ceci dit comme tout le monde je préfère, largement, le titre original, 東京物語, un conte à Tokyo), un mauvais documentaire sur les lieux où le film fut tourné et  où Ozu est enterré; on y lit le kanji qui dit rien;
où Ozu est enterré; on y lit le kanji qui dit rien; Reinaldo Arenas, alors que ma mie me suppliait d'éteindre la lumière:
Reinaldo Arenas, alors que ma mie me suppliait d'éteindre la lumière: boduf de chansons en allemand très concis parce que rien n'y est critiquable et rien n'en sera écarté; LIEDGUT est la plus belle, la plus émouvante chose électronique que j'ai entendu depuis 3000 jours, et tout le reste lui court déjà après. Vous me demanderez, qu'y entend on? Je viens de l'écrire pour le travail, je dois le réécrire pour un autre et je ne veux rien trop lui voler, mais sachez déjà que c'est un disque politique, comme la potée digitale et politique qui le précède sur la liste, qui parle de pureté, mais qui en parle très différement de ce disque précédent; il en parle en s'en acocquinant, en l'organisant sans s'en faire partisan, en la trahissant sans faire semblant, c'est un disque sur l'identité, c'est un disque sur le futur, c'est un disque sur les queues d'étoiles, sur celle de Kraftwerk, sur le moment où le coeur de Kraftwerk battait le moins régulièrement et le plus fort dans le coeur d'autres hommes (entre l'énorme "Heimatklänge" et "Morgenspaziergang", à peu près) c'est un disque sur le Trautonium et l'étrange Oskar Sala (qui, c'est assez fou, avait un peu fait aimer les sinus et les ring modulator aux Nazis), c'est un disque sur l'idiotie, la vraie idiotie, celle qui détruit le monde et la biodiversité, c'est un disque sévère, c'est un disque sur le pardon, et aussi sur le non-pardon, c'est un disque qui se voudrait le dernier, je crois, car il a une manière de s'en prendre à la voix humaine qui n'est pas très aimable, qui n'a d'égal en inaimabilité en fait que l'aimabilité avec laquelle il aime et empile les bruits amis des synthétiseur ou même les bruits ennemis des téléphones portables (je pense qu'Atom™ ne déteste rien plus au monde que les téléphones portables parce qu'ils concentrent tout ou presque de notre décadence) ou plutôt, qui ne semble rien tant aimer que de faire naître une voix qui ne pourra jamais appartenir à quiconque, la voix d'un quoi-conque (et c'est un délice esthétique, d'ailleurs les plus beaux sons électroniques entendus l'année dernière donnait aussi de la voix à quelque chose d'autre qu'un homme que ça vous plaise ou non, que l'antropomorphisme craigne ou pas), c'est un disque sur la tragédie de Schubert, sur ce que vous fait Schubert, ce que qu'on a fait à Schubert, un disque sur la fin de Schubert, un disque sur la fin de l'homme
boduf de chansons en allemand très concis parce que rien n'y est critiquable et rien n'en sera écarté; LIEDGUT est la plus belle, la plus émouvante chose électronique que j'ai entendu depuis 3000 jours, et tout le reste lui court déjà après. Vous me demanderez, qu'y entend on? Je viens de l'écrire pour le travail, je dois le réécrire pour un autre et je ne veux rien trop lui voler, mais sachez déjà que c'est un disque politique, comme la potée digitale et politique qui le précède sur la liste, qui parle de pureté, mais qui en parle très différement de ce disque précédent; il en parle en s'en acocquinant, en l'organisant sans s'en faire partisan, en la trahissant sans faire semblant, c'est un disque sur l'identité, c'est un disque sur le futur, c'est un disque sur les queues d'étoiles, sur celle de Kraftwerk, sur le moment où le coeur de Kraftwerk battait le moins régulièrement et le plus fort dans le coeur d'autres hommes (entre l'énorme "Heimatklänge" et "Morgenspaziergang", à peu près) c'est un disque sur le Trautonium et l'étrange Oskar Sala (qui, c'est assez fou, avait un peu fait aimer les sinus et les ring modulator aux Nazis), c'est un disque sur l'idiotie, la vraie idiotie, celle qui détruit le monde et la biodiversité, c'est un disque sévère, c'est un disque sur le pardon, et aussi sur le non-pardon, c'est un disque qui se voudrait le dernier, je crois, car il a une manière de s'en prendre à la voix humaine qui n'est pas très aimable, qui n'a d'égal en inaimabilité en fait que l'aimabilité avec laquelle il aime et empile les bruits amis des synthétiseur ou même les bruits ennemis des téléphones portables (je pense qu'Atom™ ne déteste rien plus au monde que les téléphones portables parce qu'ils concentrent tout ou presque de notre décadence) ou plutôt, qui ne semble rien tant aimer que de faire naître une voix qui ne pourra jamais appartenir à quiconque, la voix d'un quoi-conque (et c'est un délice esthétique, d'ailleurs les plus beaux sons électroniques entendus l'année dernière donnait aussi de la voix à quelque chose d'autre qu'un homme que ça vous plaise ou non, que l'antropomorphisme craigne ou pas), c'est un disque sur la tragédie de Schubert, sur ce que vous fait Schubert, ce que qu'on a fait à Schubert, un disque sur la fin de Schubert, un disque sur la fin de l'homme  et pendant que Alva Noto s'amuse à passer des lignes de code de programmes merdiques pour faire des beats (la pulsation c'est la vie dirait un mauvais DJ de garage new-yorkais) Atom™ use de son pouvoir pour chanter exactement le contraire, pour dire au revoir en quelque sorte; pour fêter ça, ce disque fabuleux, je rempile avec un présent: une transcription tronquée d'une conversation téléphonique avec Uwe Schmidt opérée l'été dernier, à propos du dernier Senor Coconut et livrée en version plus éditée encore dans le Trax du mois de septembre.
et pendant que Alva Noto s'amuse à passer des lignes de code de programmes merdiques pour faire des beats (la pulsation c'est la vie dirait un mauvais DJ de garage new-yorkais) Atom™ use de son pouvoir pour chanter exactement le contraire, pour dire au revoir en quelque sorte; pour fêter ça, ce disque fabuleux, je rempile avec un présent: une transcription tronquée d'une conversation téléphonique avec Uwe Schmidt opérée l'été dernier, à propos du dernier Senor Coconut et livrée en version plus éditée encore dans le Trax du mois de septembre.